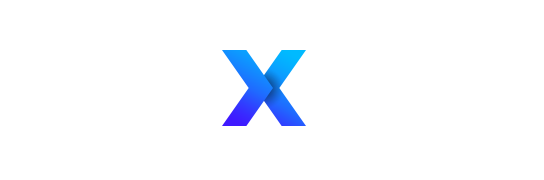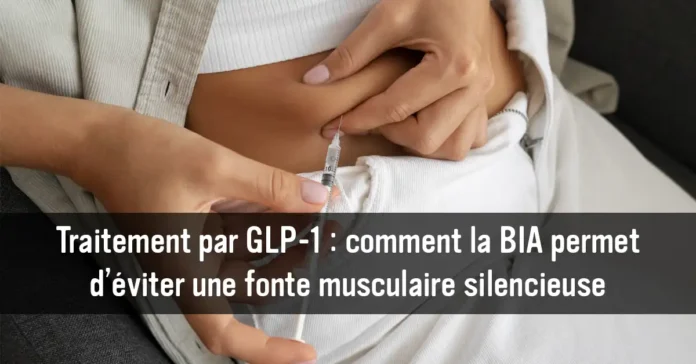I. Les mécanismes d’action du GLP-1
Depuis quelques années, les analogues du GLP-1 sont de plus en plus utilisés dans la prise en charge des patients atteints de diabète de type II ou en obésité, avec un nombre croissant de molécules présentes sur le marché. Le GLP-1, pour Glucagon-Like Peptide-1, est une molécule naturellement sécrétée par les cellules de l’intestin de manière continue, avec des pics de sécrétion à la suite d’une prise alimentaire. Il possède une action pléiotrope, i.e. sur plusieurs organes avec des effets différents1, dont les effets les plus notables sont :
- Une inhibition de la sécrétion de glucagon et une augmentation de celle en insuline favorisant une diminution de la glycémie
- Une inhibition locale de la vidange gastrique
- Une augmentation de la satiété par une action au niveau cérébral sur les centres de la régulation de la faim
L’objectif de la thérapie par les analogues du GLP-1 est d’augmenter ces trois effets en stimulant de façon plus importante son récepteur, par rapport à une situation physiologique normale, sur ces différents organes. Cela est particulièrement intéressant chez les patients atteints de diabète de type II pour limiter l’hyperglycémie et les effets délétères de la pathologie associés, mais aussi chez des individus en obésité pour la perte de poids. En effet, plusieurs études ont montré que la perte de masse corporelle induite par les analogues du GLP-1 était de 5,8 à 17,3 %, sur une durée de 56 à 72 semaines, par rapport à un placebo2.
Chez les patients en obésité, l’objectif de la perte de masse corporelle est de diminuer la masse grasse car celle-ci est à l’origine d’un environnement pro-inflammatoire responsable de nombreuses complications cliniques associées à la pathologie3. Cette perte de poids corporelle est induite par l’augmentation de la satiété et par l’inhibition de la vidange gastrique provoquant une réduction de la prise alimentaire et donc de l’apport calorique journalier. Par conséquent, cela place le patient dans une situation de déficit calorique responsable d’une diminution de la masse corporelle. Cependant il a été observé qu’environ 25 à 39% de cette perte de poids correspondait à de la masse non grasse et non à de la masse grasse4. Cette perte de masse non grasse, et donc de masse musculaire, peut être délétère pour le patient par l’apparition d’une obésité sarcopénique pouvant altérer leur capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne et favoriser une sédentarité délétère pour leur état de santé5.
A partir de ce constat, il est donc nécessaire de contrôler que la perte de masse corporelle est bien une perte de masse grasse et de maintenir la masse musculaire au cours de la prise en charge.
II. L’apport de la bioimpédancemétrie dans la prise en charge lors d’une thérapie par les analogues de GLP-1
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, l’objectif de la thérapie par les analogues de GLP-1 est de diminuer la masse grasse mais la baisse de masse musculaire observée amène également les professionnels de santé à maintenir cette dernière au maximum au cours de la prise en charge.
Dans ce contexte, il est nécessaire, en complément, une prise en charge nutritionnelle adaptée caractérisée notamment par un apport en protéines élevé et une activité physique régulière en résistance, i.e. musculation/renforcement musculaire. En plus de cela, il est également pertinent d’évaluer la composition corporelle par bioimpédancemétrie, particulièrement la masse musculaire et la masse grasse, afin de pouvoir adapter la prise en charge mais aussi d’en contrôler ses effets. En effet, l’évaluation de la masse musculaire peut permettre de détecter des profils à risque, notamment avec une masse musculaire insuffisante, et d’être vigilant lors du suivi.
D’un point de vue nutritionnel, un apport journalier supérieur à 1,6 g/kg(poids)/jour permet d’optimiser l’hypertrophie ainsi que le maintien de la masse musculaire au cours d’une perte de poids6. Cependant, la masse corporelle très élevée des patients rend impossible l’utilisation de ce chiffre en se basant sur le poids car les apports en protéines seraient gigantesques et difficiles à respecter. Par exemple, un patient de 160 kg devrait ingérer environ 256 g de protéines par jour, soit l’équivalent de 1,3 kg de viande/poisson/tofu ou encore 43 œufs, ce qui est considérable et très difficilement envisageable. Ainsi, il est donc plus intéressant de se baser sur la masse non grasse afin de fournir au patient un objectif réalisable dans la vie quotidienne, et donc conseiller un apport de 1,4 à 2,0 g/kg(masse non grasse)/jour. Si l’on reprend le cas précédent en prenant en compte un pourcentage de masse grasse de 50%, cela donne une masse non grasse de 80kg amenant à un apport de 128g de protéines, pour un apport de 1,6g/kg/j, ce qui est atteignable par une alimentation équilibrée à laquelle une supplémentation peut être associée. L’apport en protéines est crucial au cours de la prise en charge afin de maintenir la masse musculaire et que la perte observée corresponde à un réajustement normal de celle-ci par rapport au poids corporel7.
De plus, le suivi de la composition corporelle permet la détection d’une perte rapide de masse musculaire et/ou d’une stagnation de la masse grasse entraînant un ajustement de la prise en charge que ça soit au niveau médicamenteux, nutritionnel et/ou comportemental. En effet, la réussite de ce type de thérapie à long-terme est fortement associée à l’implication du patient2 et une perte de motivation peut limiter la perte de masse grasse. Dans ce contexte, la bioimpédancemétrie constitue un levier motivationnel intéressant pour maintenir l’implication du patient en lui montrant l’évolution de sa composition corporelle. Cela peut aussi être un moyen de dialoguer avec lui afin d’investiguer si des modifications de la vie quotidienne pourrait être la cause d’une baisse de la motivation et/ou de l’efficacité du traitement.
Conclusion
La thérapie par les analogues du GLP-1 constitue une approche thérapeutique d’intérêt pour la perte de masse grasse dans le cadre de l’obésité et pour le contrôle glycémique dans le diabète de type II. Cependant, celle-ci peut être responsable d’une diminution très importante de la masse musculaire, délétère pour le patient, et qui peut être contré par une prise en charge nutritionnel et par l’activité physique. Dans ce contexte, la bioimpédancemétrie est pertinente pour évaluer la composition corporelle dans le but d’orienter et de contrôler la prise en charge ainsi que pour maintenir l’implication des patients.
Bibliographie
1. Drucker DJ. Mechanisms of Action and Therapeutic Application of Glucagon-like Peptide-1. Cell Metab. 2018 Apr 3;27(4):740–56.
2. Mozaffarian D, Agarwal M, Aggarwal M, Alexander L, Apovian CM, Bindlish S, et al. Nutritional priorities to support GLP-1 therapy for obesity: a joint Advisory from the American College of Lifestyle Medicine, the American Society for Nutrition, the Obesity Medicine Association, and The Obesity Society. Am J Clin Nutr. 2025 Jul;122(1):344–67.
3. Heymsfield SB, Wadden TA. Mechanisms, Pathophysiology, and Management of Obesity. N Engl J Med. 2017 Jan 19;376(3):254–66.
4. Prado CM, Phillips SM, Gonzalez MC, Heymsfield SB. Muscle matters: the effects of medically induced weight loss on skeletal muscle. Lancet Diabetes Endocrinol. 2024 Nov 1;12(11):785–7.
5. Donini LM, Busetto L, Bischoff SC, Cederholm T, Ballesteros-Pomar MD, Batsis JA, et al. Definition and Diagnostic Criteria for Sarcopenic Obesity: ESPEN and EASO Consensus Statement. Obes Facts. 2022 Feb 23;15(3):321–35.
6. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, Schoenfeld BJ, Henselmans M, Helms E, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(6):376–84.
7. Lytvyak E, Grunvald E, Shreekumar D, Rye P, Troshyn O, Cawsey S, et al. “Super-Responders” to Liraglutide Monotherapy and the Growing Evidence of Efficacy of GLP-1 Analogues in Obesity Management: A Longitudinal Prospective Cohort Study. Obesities. 2025 Aug 20;5(3):63.