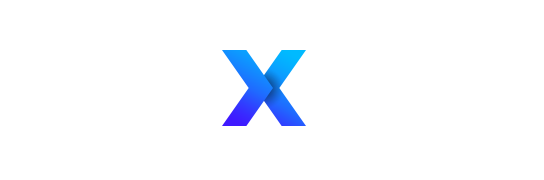La chirurgie bariatrique ne se termine pas lorsque le patient quitte la salle d’opération. Et elle ne commence pas non plus au moment de l’anesthésie. Son véritable début se situe des semaines avant, dans la préparation métabolique, et son succès à long terme se définit dans les mois suivants, avec un suivi qui va bien au-delà du poids sur la balance.
Aujourd’hui, en tant que professionnels qui accompagnons ces patients — médecins, nutritionnistes, diététiciens, kinésithérapeutes — nous avons une responsabilité claire : non seulement garantir la perte de poids, mais aussi s’assurer que cette perte soit de qualité. Que le patient ne fasse pas que maigrir, mais qu’il améliore sa fonction physique, sa masse musculaire, son état métabolique et sa qualité de vie.
Et pour y parvenir, nous avons besoin d’outils qui nous permettent de voir au-delà de l’IMC. C’est là que la bio-impédance spectroscopique (BIS) cesse d’être un complément pour devenir une pièce essentielle du suivi clinique. Mais il ne suffit pas d’avoir l’appareil. La clé est de savoir quoi mesurer, quand le faire et comment utiliser ces informations pour intervenir.
Un modèle de réussite : la rééducation fonctionnelle en France
En France, l’approche de l’obésité sévère est profondément multidisciplinaire. Après la chirurgie, de nombreux patients entrent dans des programmes de rééducation fonctionnelle, comme celui décrit par Morana et al. dans leur étude pilote (2018), qui combine exercice supervisé, éducation nutritionnelle et évaluation objective des progrès.
Dans ce programme, les patients commençaient une rééducation de 20 séances, deux mois après une sleeve gastrectomie, avec des évaluations initiales et finales qui incluaient la bio-impédance, des tests fonctionnels et la qualité de vie. Les résultats ont été clairs : amélioration significative de la composition corporelle, de la force, de la capacité cardiovasculaire et du bien-être.
Le plus intéressant : ils ont utilisé la bio-impédance non pas comme une donnée isolée, mais comme partie d’une évaluation fonctionnelle intégrale. Et c’est exactement ce que nous pouvons reproduire dans notre pratique clinique.
Pourquoi contrôler la composition corporelle avant et après la chirurgie ?
La perte de poids après la chirurgie est rapide. Et bien que l’objectif soit de réduire la masse grasse, sans une gestion nutritionnelle précise, on perd aussi de la masse musculaire, de l’eau intracellulaire et du tissu métaboliquement actif. Cette perte non visible peut se traduire par une fatigue chronique, une baisse de la dépense énergétique au repos, un risque de reprise de poids, une détérioration fonctionnelle et un risque accru de complications postopératoires.
Cela se traduit par :
- Fatigue chronique
- Baisse de la dépense énergétique au repos
- Risque de rechute
- Douleur articulaire persistante
- Perte de fonctionnalité
De plus, de nombreux patients arrivent à la chirurgie avec une inflammation subclinique, une déshydratation cellulaire ou une surcharge de liquides extracellulaires, des conditions qui ne se voient ni sur une analyse ni sur une échographie, mais que la BIS peut détecter. Surveiller la composition corporelle n’est pas un luxe. C’est une manière de prévenir les complications, de personnaliser les soins et de démontrer leur valeur avec des données objectives.
Quels paramètres de la BIS devriez-vous contrôler ? Et pourquoi ?
Toutes les données de la BIS ne sont pas également utiles. Voici les quatre paramètres fonctionnels que tout professionnel devrait prioriser dans le suivi bariatrique.
1. L’angle de phase : le thermomètre de l’état cellulaire
L’angle de phase reflète l’intégrité des membranes cellulaires. C’est un marqueur de santé cellulaire et de réserve fonctionnelle. Des valeurs basses, inférieures à 4° chez les femmes et 5° chez les hommes, sont associées à un risque plus élevé de complications postopératoires : infections, cicatrisation lente, séjour hospitalier prolongé (Cruz-Jentoft et al., 2019 ; Pérez-Moreno et al., 2021).
Chaque augmentation de 0,5° réduit la probabilité de complications de 18 % (Uribe, 2025 ; Bosy-Westphal et al., 2020 ; Norman et al., 2020). Ce n’est pas seulement une donnée technique : c’est un indicateur de risque chirurgical que vous pouvez modifier avec des interventions cliniques.
Que faire ?
Si l’angle de phase est bas, ce n’est pas le moment d’opérer. C’est le moment d’intensifier la préparation métabolique. L’angle de phase n’est pas seulement un chiffre : c’est un prédicteur de la récupération.
2. Le rapport d’impédance (IR = Z200/Z5) : détecter l’inflammation cachée
Le rapport d’impédance (IR = Z200/Z5) mesure la relation entre l’eau extracellulaire et l’eau intracellulaire. C’est un marqueur indirect d’inflammation de bas grade et de rétention d’eau. Une valeur supérieure à 0,82 a été associée à des niveaux élevés de protéine C-réactive, à une dysfonction endothéliale et à un risque métabolique plus élevé (Moissl et al., 2013 ; Wabel et al., 2015). Ce déséquilibre est courant chez les patients obèses, même avant la chirurgie.
Chertow et al. (2020) ont observé que la réduction de l’IR dans les six premiers mois postopératoires est associée à une amélioration de la sensibilité à l’insuline et à une plus grande probabilité de rémission du diabète de type 2.
Que faire ?
Un IR élevé ne se corrige pas avec des diurétiques. Il se corrige avec une approche globale : optimiser l’hydratation, ajuster la charge d’exercice et, si nécessaire, intégrer des stratégies anti-inflammatoires. Du point de vue nutritionnel, il se corrige avec une alimentation anti-inflammatoire : réduire les aliments ultra-transformés, augmenter les fibres, les oméga-3 et s’assurer d’un apport adéquat en micronutriments tels que le magnésium, la vitamine D et le zinc.
Surveillez l’IR tous les 3 mois : son amélioration est un signe d’amélioration métabolique.
3. Masse cellulaire active : protéger le moteur du métabolisme
La masse cellulaire active (BCM) est le tissu métaboliquement actif : muscles, organes, cellules sanguines. C’est le « moteur » qui brûle des calories et maintient la fonction physique. Des études ont montré que les patients qui consomment au moins 1,5 g/kg/jour de protéines conservent plus de 89 % de leur BCM à 12 mois, contre 72 % chez ceux qui en consomment moins de 1,2 g/kg/jour (Siervo et al., 2014 ; Müller et al., 2016).
La perte de BCM est associée à la fatigue, à une baisse de la dépense énergétique au repos et à un risque plus élevé d’obésité sarcopénique. Guglielmi et al. (2022) ont lié la conservation de la BCM à une dépense énergétique plus élevée et à une meilleure qualité de vie.
Que faire en consultation ?
Utilisez la BIS pour quantifier la BCM et ajustez l’apport en protéines en temps réel. Ne devinez pas : mesurez. De plus, combinez l’alimentation avec des exercices de résistance (2 à 3 fois par semaine). La BIS vous permet de montrer au patient qu’il ne perd pas de la « force », mais de la graisse.
4. Capacitance cellulaire : un nouvel indicateur de santé métabolique
Ce paramètre, moins connu mais avec un grand potentiel, reflète la capacité des cellules à stocker de l’énergie, liée à la fonction mitochondriale. Des valeurs inférieures à 0,800 pH ont été associées à la résistance à l’insuline et à la dysfonction mitochondriale (Sorrentino et al., 2021). Des augmentations postopératoires de la capacitance prédisent une amélioration de la sensibilité à l’insuline et une rémission du diabète de type 2 (Guglielmi et al., 2022 ; Sica et al., 2020).
Que faire en consultation ? Si la capacitance ne s’améliore pas après la chirurgie, il pourrait y avoir un « échec métabolique » caché. Revoyez la qualité de l’alimentation, du sommeil, du stress et de l’activité physique. La capacitance est un paramètre émergent qui peut vous aider à expliquer pourquoi certains patients ne parviennent pas à la rémission du diabète, malgré la perte de poids.
5. Un protocole pratique pour votre clinique
Savoir quoi mesurer est important. Savoir quand et comment le mesurer est essentiel. Voici un protocole basé sur des preuves et applicable dans toute consultation.
Préopératoire (4 à 8 semaines avant la chirurgie) :
Une mesure après une période de régime métabolique (hypoprotéique, hypocalorique, riche en nutriments). C’est votre point de départ. Si l’angle de phase est bas ou le rapport d’impédance est élevé, intensifiez l’intervention.
Postopératoire (première année) :
Mois 3 : premier contrôle. Évaluez la perte de masse grasse par rapport à la masse maigre.
Mois 6 : vérifiez l’IR et la BCM. Y a-t-il une inflammation résiduelle ? Y a-t-il une perte de muscle ?
Mois 9 et 12 : évaluez la stabilisation et la fonctionnalité.
Années suivantes :
Contrôles semestriels pour détecter une perte musculaire précoce ou une réaccumulation de graisse.
Recommandations pour utiliser votre appareil de BIS avec précision
Pour que vos mesures soient reproductibles et comparables, suivez ces directives :
- Suivez scrupuleusement la technique suggérée par le fabricant.
- Jeûnez 3 heures avant la mesure.
- Reposez-vous en position allongée pendant 10 minutes avant de placer les électrodes. Dans le cas où vous auriez besoin de les utiliser, rappelez-vous que notre BX ZMII est unique au monde car vous pouvez l’utiliser avec ou sans câbles.
- Si vous utilisez les câbles, les électrodes doivent être placées dans une position standardisée : main et pied du même côté, sans croiser le corps.
- Évitez l’exercice ou une hydratation excessive dans les 12 heures précédentes.
- N’oubliez pas de peser et de mesurer le patient correctement ; ne vous limitez pas à sa perception de son poids, car elle est généralement erronée et génère des biais dans les résultats.
Conclusion : de la balance aux soins personnalisés
La chirurgie bariatrique ne se termine pas lorsque le patient quitte la salle d’opération. Une nouvelle phase commence : l’accompagnement nutritionnel, fonctionnel et métabolique. Et à ce stade, la balance ne suffit plus. La bio-impédance spectroscopique vous permet de voir au-delà du poids, de comprendre ce qui se passe à l’intérieur du corps et d’agir avec précision. Il ne s’agit pas d’avoir plus de données, mais d’avoir les bonnes données au bon moment.
Si vous utilisez ou envisagez d’utiliser un appareil de BIS, commencez par ces quatre paramètres : angle de phase, rapport d’impédance, masse cellulaire active et capacitance cellulaire. Ce sont des outils scientifiquement validés qui vous permettent de :
- Prévenir les complications
- Personnaliser l’apport en protéines
- Détecter l’inflammation cachée
- Démontrer votre valeur avec des preuves objectives
Chez Aminogram, nous croyons que l’avenir des soins de santé est fonctionnel, préventif et personnalisé. Et la BIS n’est pas seulement un appareil : c’est une philosophie de soins.
Références
- Bosy-Westphal, A., Dirlewanger, M., Willershäuser, M., et al. (2020). What makes individuals with high BMI lose weight successfully? A prospective study on the role of body composition. International Journal of Obesity, 44(6), 1234–1243. https://doi.org/10.1038/s41366-020-0577-3
- Chertow, G. M., Block, G. A., Correa-Rotter, R., et al. (2020). Effect of calcimimetics on cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis: Secondary analysis of the EVOLVE trial. American Journal of Kidney Diseases, 75(1), 37–47. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2019.06.011
- Cruz-Jentoft, A., Bahat, G., Bauer, J., et al. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing, 48(1), 16–31. https://doi.org/10.1093/ageing/afy169
- ESPEN. (2021). Clinical guidelines on nutrition in surgery. Clinical Nutrition, 40(3), 1344–1364. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.05.013
- Guglielmi, V., Iannelli, A., Pucci, A., et al. (2022). Body composition analysis in bariatric surgery: The role of bioelectrical impedance spectroscopy. Obesity Surgery, 32(10), 4278–4285. https://doi.org/10.1007/s11695-021-05872-6
- Mechanick, J. I., Apovian, C., Brethauer, S., et al. (2022). Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric surgery: Update. Surgery for Obesity and Related Diseases, 18(7), 685–710. https://doi.org/10.1016/j.soard.2022.05.009
- Moissl, U. M., Wabel, P., Chamney, P. W., et al. (2013). Body fluid volume determination via body composition spectroscopy in healthy subjects. Physiological Measurement, 34(9), 1007–1019. https://doi.org/10.1088/0967-3334/34/9/1007
- Morana, C., Collignon, M., & Nocca, D. (2018). Effectiveness of a functional rehabilitation program after bariatric surgery: A pilot study. Obesity Surgery, 28(7), 2077–2084. https://doi.org/10.1007/s11695-018-3167-3
- Müller, M. J., Enderle, J., & Bosy-Westphal, A. (2016). Functional body composition and related outcomes in response to weight loss in humans. Annals of Nutrition and Metabolism, 68(2), 69–80. https://doi.org/10.1159/000447575
- Pérez-Moreno, P., Herrera, P., Trujillo, A., et al. (2021). Phase angle as predictor of complications in bariatric surgery: A prospective cohort study. Clinical Nutrition, 40(4), 1818–1824. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.015
- Sica, G. W., Verardi, L., Ricci, F., et al. (2020). BIA in the assessment of body composition in bariatric patients: A comparative study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 30(12), 2028–2035. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2020.07.008
- Siervo, M., Montagnese, C., Wells, J. C., et al. (2014). Methodological issues in the assessment of body composition in bariatric patients. Obesity Reviews, 15(6), 449–460. https://doi.org/10.1111/obr.12167
- Sorrentino, E., Martelli, G., Castelli, M., et al. (2021). Impedance-based assessment of cellular capacitance as a marker of mitochondrial function. Cell Metabolism, 33(4), 785–796.e5. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.02.005
- Uribe, G. de J. (2025). Body composition of the Latin American population and the risk of non-communicable chronic diseases mediated by multifrequency bioimpedance (mfBIA) [Unpublished doctoral dissertation]. Fundación Universitaria Iberoamericana de México, FUNIBER. Pending approval.
- Wabel, P., Moissl, U. M., Chamney, P., et al. (2015). Total body water and extracellular water compartments by dilution vs. bioimpedance. Kidney International, 88(3), 588–595. https://doi.org/10.1038/ki.2015.125